

Zachary Richard : Quelque chose comme un géant
Zachary Richard est tellement plus qu’une figure marquante, qu’une vedette. Le Louisianais s’est fait, au fil du temps, porte-parole d’une culture qui aurait fort bien pu s’évaporer dans la nature – n’eut été de lui et de ses mots.
Catherine Genest
Photo : Philippe Ruel / Courtoisie Festival de la chanson de Tadoussac
Rejoint au lobby de l’Hôtel Tadoussac, non loin de l’église désacralisée d’où il s’offrira en spectacle quelques heures plus tard, Zachary Richard irradie de bonnes vibes, d’un genre de charisme métaphysique. Le plus célèbre Cadien qui soit, et de loin, impose le respect, fascine. Chaque phrase semble cueillie à point nommé, mûrie à la manière d’un sage. Et on l’écrit sans égard à ses 68 printemps, sa chevelure aux reflets d’argent. De tout temps, le natif de la paroisse de Lafayette se sera imposé comme une force tranquille, cet être réfléchi et posé.
Le trac? “Je l’ai jamais eu”, admet-il de sa voix presque chuchotée, granuleuse et consolante à la fois, avant d’y aller d’une confession étonnante. Surtout en début d’entrevue, comme ça.
“J’ai commencé à chanter à l’âge de huit ans à l’église. […] Ce n’est pas quelque chose qui m’intimide. C’est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir. Bon, enfin, les seules fois où je suis quand même un peu anxieux, c’est pour l’hymne national américain. Je l’ai fait dans le contexte de grands événements sportifs. C’est une chanson abominable. Une fois, ça n’a pas duré longtemps, mais j’ai voulu quitter le métier parce que j’étais humilié. Je l’ai fait sur la télévision nationale américaine pour le championnat de basketball qui se passait à La Nouvelle-Orléans dans le Superdome devant 80 000 spectateurs. Le truc avec l’hymne national, c’est qu’il faut avoir exactement la bonne tonalité. Ça commence bas et ça finit haut donc je savais exactement quelle note que je devais chanter. J’avais mon petit pitch pipe. Puis, on m’a présenté, j’ai marché vers la fanfare de LSU qui jouait Hold that Tiger à environ 50 000 décibels. Je m’entendais pas. Ce qui fait que lorsqu’ils ont arrêté, c’était à moi. J’ai fait, oh shit! et dès que j’ai ouvert ma bouche, je savais que j’avais choisi une tonalité bien plus haute.”

Personne, pas même les légendes vivantes, ne sont assurées contre les problèmes techniques, les aléas de la scène. Modeste et généreux, Zachary Richard, à première vue, est précisément ce comment on l’imaginait, ce comment il s’est présenté toute sa vie publique durant devant les caméras. Un gars humble malgré l’ambition que sa mission socio-linguistique sous-tend, malgré le succès qui s’accorde au pluriel, se multiplie par deux. “C’est drôle parce que les Québécois soupçonnent pas que j’ai passé 15 ans de ma vie aux États-Unis et que j’ai une carrière américaine qui existe encore malgré le fait que je la néglige un peu. Et les Américains, eux, ils ont aucune idée de la place que je prends au Québec! Moi ça m’amuse plutôt qu’autre chose. Tout ça pour dire que je vis très, très bien avec cette espèce d’ambiguïté culturelle.”
C’est vrai, on l’oublie. Bien que cette portion de sa biographique reste largement méconnue dans la Belle Province, le Louisianais a d’abord fait ses dents comme chanteur dans la langue de Dylan. Jeune adulte, il aura même vécu un temps à New York jusqu’à ce que ses racines ne le rattrapent, qu’une étincelle ne vienne à jaillir en lui.
Mais comment-a-t-il, un jour, choisi de célébrer son héritage cajun en musique? D’honorer, en quelque sorte, la mémoire de ceux qui peuplent son arbre généalogique?
“Ça c’est très, très curieux. Pour mettre ça en contexte, mes grands-parents étaient unilingues francophones, tant du côté de ma mère que de mon père, mais la musique dite traditionnelle, je la connaissais pas. Je n’étais pas d’une famille de musiciens. Mes parents écoutaient la musique typique de leur génération, ils aimaient Glenn Miller, les big bands de la Deuxième Guerre mondiale, alors moi j’ai été élevé dans le creuset de la musique populaire américaine. Mais quand j’avais 14 ans, j’ai entendu Yesterday par The Beatles à la radio. Ça m’a complètement bouleversé. Tout ça pour dire que ma culture musicale était complètement anglophone. J’ai signé un contrat de disque à 21 ans quand j’étais à New York. On m’a donné 2500$ en avance et j’ai acheté plein de guitares, mais il me restait 500$ donc je suis allé acheter un accordéon diatonique couleur de bordeaux. J’étais fasciné par ça, j’y connaissais rien, mais il y avait une grande mode à l’époque de retour aux sources. C’est comme ça que j’ai commencé à apprendre les chansons traditionnelles par intérêt. […] Je me souviens d’avoir fait une tournée en France en 73. Je jouais mes chansons folk américaines et les gens applaudissaient poliment, mais quand je jouais l’accordéon, ça devenait fou! C’est là que j’ai pris une tournure, allons dire, francophone. J’ai sorti Bayou des mystères puis Mardi Gras et dans ce deuxième album-là, c’était en grande partie des traductions des chansons que j’avais composées en anglais. Moi j’ai toujours habité avec confort sur la frontière entre les deux cultures.”
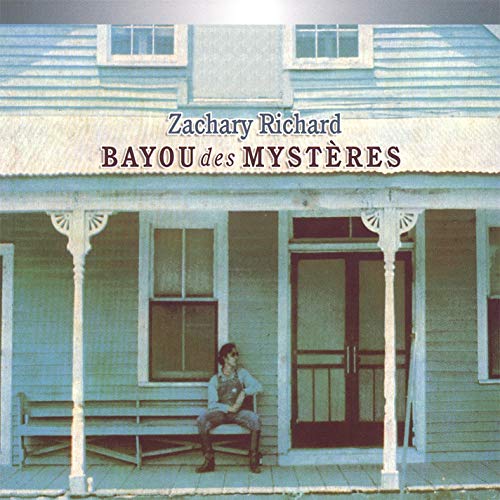
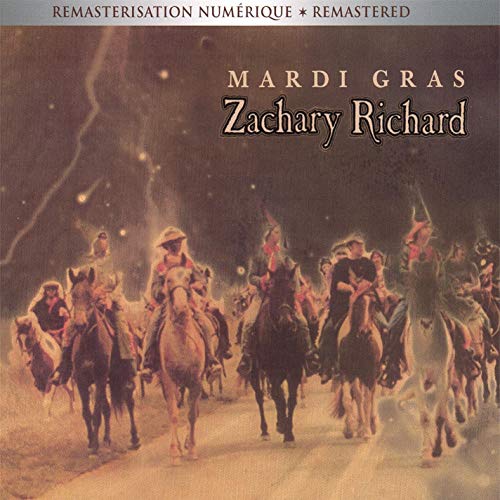
Paveur de voies
Il est de ceux qui pourraient fort bien s’asseoir sur leurs lauriers, s’accoter tout bonnement sur leur répertoire encore florissant. Or, Zachary Richard est créativement très en forme. L’encre, mine de rien, coule encore à flots sur ses pages qui ne restent que très peu de temps blanches.
De son album Gumbo paru il y a seulement deux ans, un titre résonne plus fort encore que tous les autres: Y’a un vent qui me ramène. Le morceau, qu’il vient d’ailleurs de sortir sous l’égide du single, s’articule autour d’une habile métaphore qui évoque la déportation et l’assimilation de ses ancêtres. Des thèmes centraux et à jamais associés à son oeuvre qu’il se plaît encore à aborder avec fougue et poésie. “En 1916, on a réussi à bannir le français de la place publique. Il n’y avait plus de loi qui ordonnait de ne plus parler français. C’était beaucoup plus sournois que ça. On a tout simplement obligé aux enfants d’aller à l’école. Il y avait une loi sur l’éducation publique qui obligeait les parents à envoyer leurs enfants à l’école, mais évidemment, c’était un système anglo-américain.”
[youtube]ao68Wzkp6hg[/youtube]
En un siècle, de même qu’entre la sortie de Cap Enragé (1996) et ce nouvel opus, la situation du français en Louisiane a beaucoup évolué. Pour le mieux, de surcroît, avec toutes ces écoles d’immersion française qui ont ouvert leurs portes et la percée de groupes musicaux comme [youtube href= »https://www.youtube.com/watch?v=SeZF88iEhlA »]Sweet Crude[/youtube] ou Bonsoir Catin. Forcément, Zachary le défricheur y est pour quelque chose.
Les échos du Sud
Qu’il soit en Acadie, au Québec ou dans ses terres, l’homme au coquet accent reste souvent mépris pour un étranger ou, presque plus étonnant encore, pour un Créole. Une confusion sempiternelle qui tranche avec les tensions qui divisent les deux peuples francophones du Deep South. Explications. “Créole, ça veut tout simplement dire “du nouveau monde”. Criollo, ça vient de l’espagnol. Ça peut être utilisé pour une tomate, un poney, n’importe quoi. Donc si on veut respecter l’étymologie du mot, moi, je suis un créole d’héritage acadien. Mais moi, je ne me présente jamais comme ça! […] C’est très compliqué parce que tu ajoutes à ça des questions raciales, d’ethnicité. Hier, je lisais justement l’article d’un collègue historien en Louisiane. Il résiste à une espèce d’attaque des historiens créoles qui veulent amoindrir l’importance du mot “cajun” parce que bon, l’équipe de football à Lafayette s’appelle les Ragin’ Cajuns, le stade s’appelle The Cajun Dome et tout ça… Il y a une certaine partie de la communauté qui est vexée par cette espèce d’appropriation du lieu public par les Cajuns. C’est très, très compliqué et c’est dommage parce que, finalement, ça empêche surtout les deux communautés d’héritage français, à la fois les Créoles noirs et Cajuns, de se réunir autour de la question de la langue parce qu’il y a un fond de conflit racial qui complique la chose davantage.”
C’est plutôt autour du zarico (ou zydeco) que les deux solitudes se prêtent à un mariage. Créé par les Cadiens, mais rapidement embrassé par les créoles afro-descendants, ce dérivé du blues contribue à une espèce de trêve. Et Zachary Richard, de par ses influences joyeusement éclectiques, s’inscrit dans le même esprit. “Je ne suis pas un musicien de zarico, mais je ne suis pas un musicien cajun non plus. Mon style est un mélange. J’ai toujours résisté à la notion des étiquettes, toujours fait chier les puristes en Louisiane et à mon grand bonheur! Moi ce qui m’intéresse, c’est justement de pouvoir faire des métissages et non pas de trier des choses.”
En alliant folk, zarico, blues, reggae (sa version de L’arbre est dans les feuilles l’était totalement), rock’n roll et une pléiade d’autres trucs, Zachary Richard se fait architecte d’un son intrinsèquement universel. Quatre décennies après la parution de Bayou des mystères, force est d’admettre que cette mixture, cette proposition ouverte sur les autres sonne toujours aussi bien, aussi neuve. “En Louisiane, il y a une très, très grande solidarité dans la communauté musicale, une solidarité qui n’a rien à voir avec la couleur de la peau. C’est ce qui est intéressant, justement, ce mélange de l’Afrique, de l’Europe, de français, d’anglais et d’espagnol. C’est ça qui fait la richesse du pays à mon avis.”
En spectacle:
7 août au Parc Quintal (Sherbrooke)
15 août au Congrès Mondial Acadien (Dieppe)
16 août au Parc Riverin (Moncton)
26 septembre au Théâtre Banque Nationale (Saguenay)
11 octobre à la Salle Rolland-Brunelle (Joliette)
17 octobre au Complexe Culturel Guy-Descary (Lachine)
19 octobre à la Maison de la culture Mercier (Montréal)
23 et 24 octobre au Théâtre Petit Champlain (Québec)
25 octobre Domaine Forget (Charlevoix)
1er et 2 novembre au Centre d’art La Petite Église (Saint-Eustache)
[youtube]iRMY_Llzd-I[/youtube]
