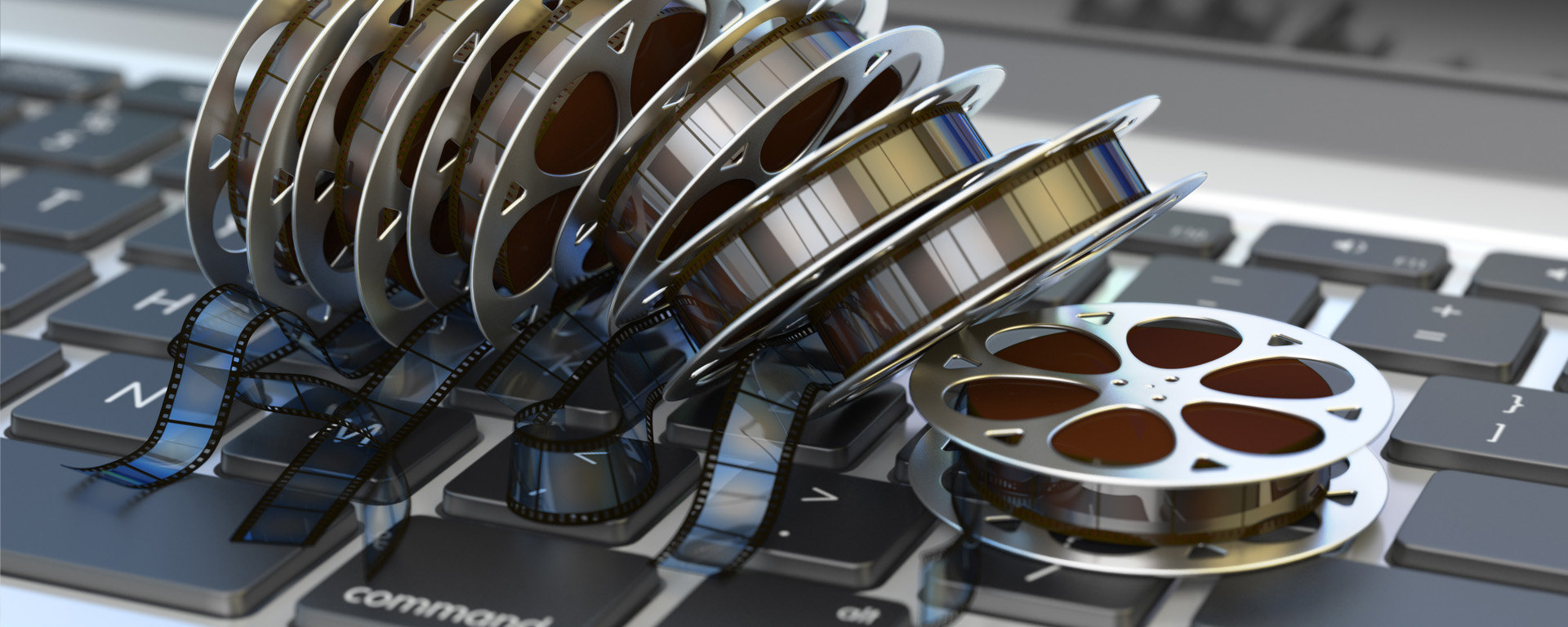
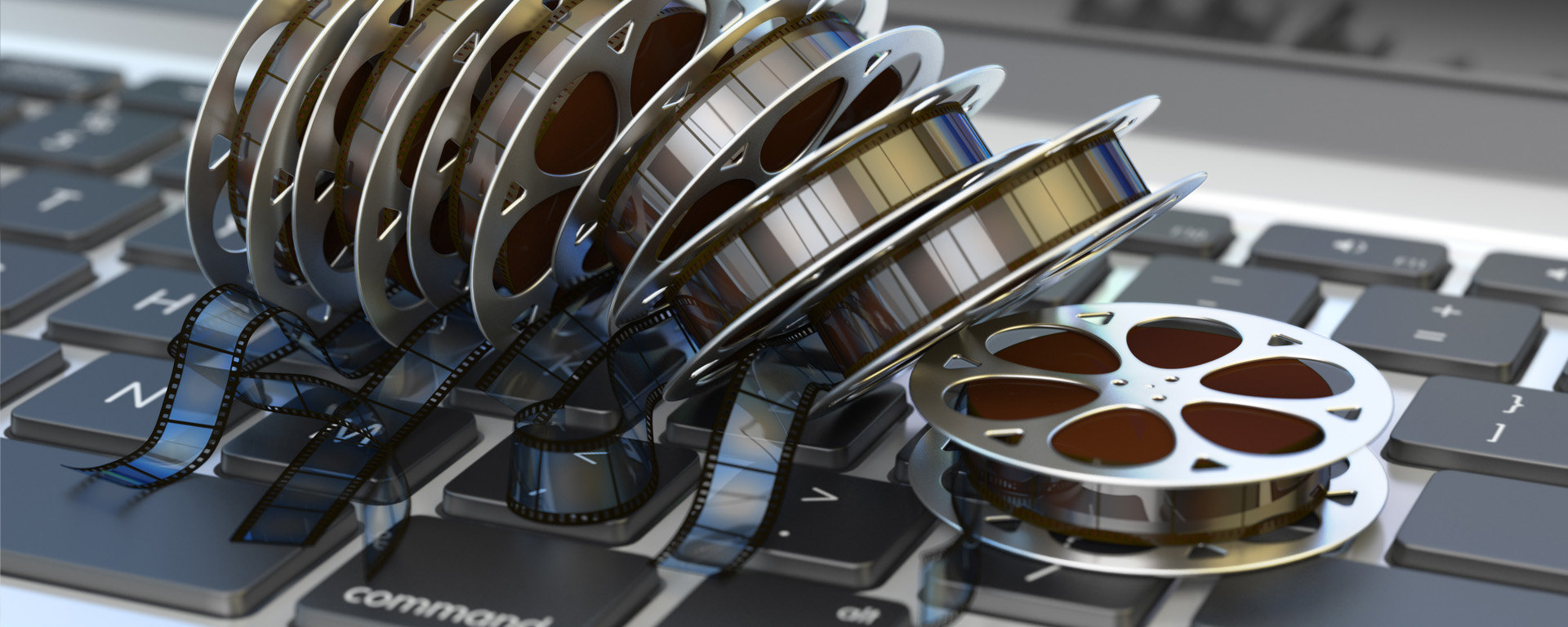
Netflix, le géant à amadouer
Netflix, l’incontournable plateforme vidéo, a depuis longtemps étalé ses tentacules au Québec, où son nombre d’abonnés est grandissant. Mais l’entreprise californienne offre peu de contenu local et refuse de jouer selon les règles de diffusion en vigueur chez nous. Faut-il ou non faire affaire avec le géant? Discussion avec des distributeurs québécois qui sont bien ambivalents.
Philippe Couture et Jean-Philippe Cipriani
Impossible de connaître le nombre exact d’abonnés à Netflix au Québec, puisque l’entreprise refuse de révéler ses chiffres et que les statistiques de l’Observatoire de la culture ne nous apprennent rien à ce sujet. Mais personne ne doute de sa progression rapide chez nous, où la plateforme séduit d’emblée un public jeune et branché.
Mais à part pour y regarder en boucle les vieux épisodes de Friends (un plaisir même pas coupable) ou pour visionner des films hollywoodiens tonitruants, le cinéphile québécois se heurte à un mur: le contenu québécois et canadien s’y fait rare. Ironie du sort, à cause de la force de certains distributeurs étrangers qui possèdent les droits de films québécois, quelques-uns de nos grands films sont disponibles sur Netflix aux États-Unis ou en Angleterre alors qu’on ne les trouve pas sur Netflix Québec. C’est le cas de Mommy, de Xavier Dolan, pour ne nommer qu’un exemple célèbre. À première vue, le géant ne semble pas particulièrement intéressé à notre trop petit marché et ne fait affaire qu’avec les grands. Des ententes avec des diffuseurs locaux de télévision ou de télévision payante ont aussi souvent préséance: les distributeurs de chez nous ne se précipitent pas toujours vers l’entreprise américaine en premier lieu.
Certes, on a pu y voir, pendant quelques courtes semaines, le film Diego Star, de Frédérick Pelletier, ou Autrui, de Micheline Lanctôt (tous deux distribués par Métropole Films). Laurence Anyways, de l’enfant chouchou Xavier Dolan, y a figuré au catalogue. Un partenariat avec Radio-Canada avait momentanément permis d’y retrouver quelques séries d’ici, comme Les Parent, La galère et Les invincibles. Mais ça n’a pas duré très longtemps.

Dans un contexte de diffusion difficile dans nos salles, alors que nos films peinent à tenir l’affiche plus de trois semaines et pénètrent difficilement le marché des régions, la diffusion sur des plateformes comme Netflix ou Shomi (le nouveau service de Rogers) ou sur des sites de vidéo sur demande (VSD) est une manière de prolonger la vie des longs métrages d’ici et pourrait les aider à traverser nos frontières. On trouve d’ailleurs du contenu québécois en VSD sur plusieurs plateformes (VHX, Illico, ICI tou.tv, ONF et j’en passe). iTunes est un autre joueur, avec lequel de nombreux distributeurs d’ici ont des ententes. Mais peut-on vraiment se passer de Netflix, qui demeure la plateforme la plus populaire et le joueur le plus important?
À ce sujet, les avis divergent. Depuis que le CRTC a essuyé de nombreux refus de Netflix dans ses tentatives de réglementer la plateforme et de la soumettre à une obligation de contribuer au Fonds des médias du Canada (FMC), nombreux sont les distributeurs québécois qui ont jeté l’éponge ou qui préfèrent se tourner vers d’autres initiatives. L’entreprise américaine prétend qu’elle n’est pas soumise à la juridiction du CRTC puisqu’elle n’a aucune présence physique au Canada. Mais pour combien de temps pourra-t-on ignorer le colosse, quand les consommateurs, eux, continuent de s’y abonner à peu de frais?
Netflix est un pirate international, on ne le dira pas assez. Et de l’encourager, c’est contribuer à détruire notre industrie culturelle.
Traiter avec Netflix, rêve ou réalité?
Est-il même envisageable, pour un distributeur québécois de taille plus modeste que la plupart de ses homologues américains ou français, de tenter de faire affaire avec Netflix? Il y a plusieurs réponses à cette question.
Les plus radicaux, comme Louis Dussault, à la tête de K-Films Amérique, refusent tout simplement de traiter avec le diable. «Nous ne collaborons pas avec Netflix, pas plus que j’appelle Uber X pour prendre un taxi. Netflix, en ne payant ni taxes ni impôts, est un prédateur de notre marché, sans aucune obligation du CRTC: pas de cahier de charges, comme ses compétiteurs doivent en avoir pour obtenir une licence d’exploitation. Je pense à Illico, Bell.net, Telus ou encore Super Écran, qui sont obligés d’avoir du contenu québécois, et qui achètent systématiquement nos films. Netflix est un pirate international, on ne le dira pas assez. Et de l’encourager, c’est contribuer à détruire notre industrie culturelle.»

Ça a le mérite d’être clair. Netflix, d’ailleurs, puisqu’il s’agit d’un service d’abonnement au même titre que les chaînes câblées, est à considérer comme une télévision payante. Son offre se construit par ententes de diffusion aux clauses variées et à la longévité très variable: ce n’est pas un service de catalogue de films comme iTunes, où les films sont achetés et conservés pour de très longues périodes. Ainsi, les distributeurs d’ici vont souvent préférer offrir l’exclusivité de ce type de diffusion à Super Écran, qui est implanté ici depuis plus longtemps et qui respecte toute la réglementation en plus de s’impliquer dans la production de notre cinéma dès les premières étapes de préproduction.
«Tous nos films, explique Francis Ouellette de FunFilm Distribution, obéissent à un parcours par étape, d’abord une exploitation en salle puis à la télévision, et je pense qu’il est important de préserver cet espace de diffusion dans lequel notre cinéma est mieux mis en valeur. Une plateforme comme Netflix est considérée en second lieu.» Même son de cloche chez Olivier St-Pierre, responsable ventes et vidéo chez Métropole films, qui n’hésite pas à vendre des films à Netflix (via un partenariat avec Mongrel Media) mais qui favorisera toujours d’abord, pour son contenu québécois, les télévisions payantes ou la VSD. C’est le catalogue de films français de Métropole qui se fraie davantage un chemin sur Netflix. «Mais soyons clairs, poursuit St-Pierre, la diffusion du cinéma est en grand bouleversement actuellement et tout le monde cherche la manière de tirer son épingle du jeu sans connaître la solution miracle. Exclure complètement la collaboration avec Netflix, ce serait trop obstiné et certainement pas une bonne idée sur le plan commercial. Il faut rejoindre le public par tous les moyens possibles.»
Néanmoins, la réalité est que bon nombre de distributeurs québécois ne sont pas de taille – Netflix est un gros joueur et, comme tous les gros joueurs, négocie avec des entreprises de sa taille. «Il faut être capable de fournir un certain volume pour faire une entente avec Netflix et il est évident que de nombreux distributeurs québécois ne peuvent fournir ce volume», précise Olivier St-Pierre. Métropole s’est tissé un chemin via son partenaire torontois, Mongrel Media. C’est souvent par ce type d’associations que la chose devient possible. Eye Steel Films, par exemple, a déjà procédé en collaboration avec un partenaire américain. «Mais il est clair que Netflix n’a pas besoin du public francophone d’Amérique du Nord, dit Damien Detcheberry. Il vaut mieux dans ce contexte miser sur la VSD sur différentes plateformes, à prix plus raisonnable d’ailleurs, et en gardant davantage le contrôle sur notre produit.»
D’ailleurs, un distributeur québécois peut-il vraiment faire une bonne affaire en vendant un film à Netflix? Peut-il vraiment récolter son dû? «Je ne peux pas vous révéler les chiffres, répond Olivier St-Pierre, mais chez Métropole, on y trouve assez d’intérêt financier pour juger que ça vaut le coût. Netflix ne respecte pas la fiscalité québécoise et on peut le déplorer, mais évidemment, pour demeurer un partenaire d’affaires crédible, l’entreprise respecte les distributeurs et les droits de manière raisonnable.» On n’en saura pas beaucoup plus.
Il faut sans doute réfléchir ensemble à la promo davantage qu’à une nouvelle plateforme de VSD.
Netflix, et après?
Netflix ou pas, la nécessité d’une discussion collective au sujet de l’accessibilité en ligne de nos films semble s’imposer. Faut-il des fonds publics pour aider les petits distributeurs à développer des partenariats avec de gros joueurs? Faut-il inventer de nouvelles plateformes de VSD ou de diffusion par abonnement? Faut-il créer un organisme de concertation pour que tous les joueurs soient au même diapason et, surtout, que le public soit mieux guidé dans sa fréquentation des différentes plateformes?
«Netflix a une immense avance sur les autres, dit la présidente de la SODEC Monique Simard, à cause de son pouvoir de diffusion, mais aussi à cause de ses algorithmes puissants qui lui permettent de mousser des contenus que les consommateurs veulent. Ils connaissent les goûts des Québécois, dans toutes les niches de cinéma, mieux que toutes nos entreprises locales ou nos institutions. Mais il est important de ne pas penser que Netflix est seul au monde et, à la SODEC, ce qui m’importe est que notre cinéma soit accessible facilement, peu importe la plateforme utilisée. Si les distributeurs se regroupent et arrivent à s’entendre sur leurs besoins communs en matière de VSD, on peut les aider à dégager une vision, des principes de base, qui nous permettront de les soutenir dans leurs initiatives.»
Plusieurs distributeurs rêvent de cette concertation. «Il y a de la VSD partout, même sur le site de Cineplex, dit Francis Ouellette, mais je pense qu’on aurait intérêt à essayer de se regrouper pour trouver une formule permettant de centraliser un peu tout ça. Pour le consommateur, ce morcellement n’est pas idéal. Je pense aussi qu’il faut qu’un organisme joue le rôle de médiateur entre les distributeurs et certaines plateformes comme iTunes, qui n’est pas fermé aux productions locales, mais avec qui les négociations sont parfois compliquées parce qu’il n’y a pas, comme d’ailleurs chez Netflix, d’interlocuteur à l’échelle locale. Il faut pouvoir créer un dialogue à long terme.»

«Les distributeurs sont bien sûr en concurrence les uns avec les autres, dit Monique Simard, mais cela ne devrait pas exclure un peu de collaboration, dans un monde changeant où les choses bougent extrêmement vite et déroutent un peu tout le monde. Il faut favoriser la coopétition, comme le disent les jeunes entrepreneurs du web et des milieux technologiques, qui ont compris depuis longtemps qu’une concurrence complète, sans collaboration, n’allait rendre service à personne.»
Et la création d’une nouvelle plateforme de VSD, financée par des fonds publics et dédiée à la diffusion de notre cinéma national, serait-elle une bonne idée? «Non, tranche Damien Detcheberry. Le consommateur cherche des plateformes où le contenu québécois côtoie le contenu international, parce que cela reflète ses goûts. La ghettoïsation de notre cinéma sur un portail national serait un échec, à mon avis.»
«On pourrait trouver un moyen commun de promouvoir les films déjà en ligne sur différentes plateformes, pense Olivier St-Pierre. Car notre problème actuel est de rejoindre les gens. Il faut sans doute réfléchir ensemble à la promo davantage qu’à une nouvelle plateforme de VSD.»
Pour Monique Simard, il faut aussi, avant toute chose, penser plus largement et, notamment, agir à l’échelle des fournisseurs de connexion Internet, par qui transite aujourd’hui toute la consommation culturelle dématérialisée. «Dans quelques semaines, ajoute-t-elle, vont débuter de grandes consultations publiques sur la politique culturelle. C’est un moment important. Tout le monde doit se servir de ce processus pour aller dire ce qu’il a à dire. Le numérique n’existait pas il y a 25 ans quand l’ancienne politique culturelle a mené à la création d’outils communs de développement comme la SODEC. Ça passe par là.»

Le CRTC? Connais pas
par Jean-Philippe Cipriani
Quand la porte-parole de Netflix a refusé de fournir le nombre de ses abonnés au Canada devant le CRTC, en septembre 2014, le président de l’organisme, Jean-Pierre Blais, s’est énervé.
«Vous suggérez que nous ne traitons pas l’information de façon confidentielle, je trouve cela plutôt offensant», a-t-il lancé, avant de suspendre l’audience et de quitter la salle. Il a menacé de prendre une décision sans tenir compte de leur avis. En vain.
Vingt mois après cette réaction théâtrale, qu’est-ce qui a changé? «Rien n’a changé», répond du tac au tac Michael Geist, de la Chaire de recherche en droit d’Internet et du commerce électronique de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. «Ni les règles ni les lois.»
En ligne depuis six ans au Canada, Netflix demeure discrète sur le nombre de ses abonnés au Canada, de même que sur le contenu canadien sur sa plateforme, ses investissements en production canadienne et ses revenus publicitaires. L’entreprise invoque des raisons de concurrence.
Dans les faits, Netflix fonctionne toujours comme une exception aux règles du CRTC: contrairement aux câblodistributeurs traditionnels, elle n’impose pas à ses clients les taxes provinciales et fédérales sur ses services, et ne verse pas une partie de ses revenus dans le Fonds des médias du Canada, qui accorde des subventions aux productions locales.
Netflix n’a également aucune obligation de respecter les quotas de production de contenu canadien.
«C’est deux poids, deux mesures, juge Pierre Trudel, professeur de droit à l’Université de Montréal. Vous avez des entreprises qui sont réglementées, et qui ont des obligations. Et vous avez des entreprises comme Netflix qui proposent la même chose, mais qui sont exemptées de toutes ces exigences.»
Bref, c’est Uber, version télé. À la différence que Netflix semble agir en parfaite légalité. Et c’est en partie la faute du CRTC, selon M. Trudel.
«En 1999, le CRTC a décidé de ne pas réglementer le contenu sur Internet, comme si ça n’existait pas. Il s’est privé de toute possibilité d’influencer la manière dont le marché allait évoluer. Et pendant des années, il a dit sans rire qu’il y avait lieu d’exempter toute entreprise qui opère sur Internet parce que ça n’a pas d’impact sur le système de radiodiffusion. Faut le faire!»
Le résultat, ajoute-t-il, c’est que la réglementation que doivent respecter et appliquer les câblodistributeurs traditionnels perd toute sa légitimité. «À quoi sert-il de leur imposer des règles, alors?» Difficile de remettre le dentifrice dans le tube.

La «taxe Netflix»
Plusieurs intervenants, dont Radio-Canada, Bell et Rogers, ont suggéré d’imposer une redevance à Netflix et Google afin de soutenir la production de contenu canadien. Une idée que le gouvernement conservateur avait rejetée en la qualifiant de «taxe Netflix».
Pendant la campagne électorale, les libéraux s’étaient eux aussi engagés à ne pas imposer ce genre de redevance. Il faut dire que plusieurs doutent de la compétence du CRTC de réglementer les entreprises comme Netflix.
Le problème n’est pas exclusif au Canada. En Europe aussi, Netflix est perçue comme une menace aux diffuseurs traditionnels. La multinationale, basée en Californie, a installé plusieurs filiales dans des États européens reconnus comme des niches fiscales.
Ce qui lui permet aussi de se soustraire, en France par exemple, aux quotas de contenu français et à l’obligation de contribuer au financement de la création.
Avec des revenus publicitaires en baisse, et la baisse des abonnements à la télé traditionnelle, les moyens financiers de Netflix sont toutefois alléchants. L’entreprise revendique une capitalisation boursière de près de 44 milliards de dollars à la bourse NASDAQ.
En théorie, le CRTC pourrait traîner Netflix et Google devant les tribunaux afin de les forcer à collaborer. Mais rien n’assure qu’il gagnerait, surtout parce que les entreprises fonctionnent à partir de l’étranger. Et dans le cas d’une victoire, difficile de les forcer à se conformer à des ordonnances canadiennes.
«Le CRTC a évalué la possibilité d’aller en cour, rappelle M. Geist. Mais il a renoncé. Parce qu’il n’est pas évident que Netflix ne respecte pas les règles. Oui, elle refuse de fournir ses données. Mais la question du pouvoir du CRTC de réguler reste entière.»
Surtout, rappelle-t-il, que les câblos canadiens profitent quand même d’avantages de production et de diffusion que Netflix n’a pas. Selon lui, ces derniers militent surtout pour assouplir leurs propres règles, plutôt que d’en imposer à Netflix.
Le CRTC tentera-t-il à nouveau de dompter Netflix? «C’est possible, à la lumière de son influence grandissante, estime M. Geist. Cela dit, il ne semble pas y avoir d’appétit politique, même public, pour de nouvelles règles.» Il croit qu’on pourra au minimum s’entendre pour imposer les taxes de vente, comme la TPS et la TVQ.
Pierre Trudel, lui, en a contre le «discours naïf» sur la liberté d’Internet, selon lequel l’État ne doit pas intervenir. Une rengaine libertarienne hostile à toute réglementation.
«Y a une croyance très tenace selon laquelle on ne peut rien faire sur Internet. Essayez de distribuer des produits pharmaceutiques sur Internet, ou des produits financiers, vous avez de bonnes chances de vous faire attraper!»
Il craint carrément la fin du système de radiodiffusion tel qu’on le connaît. «Une grande partie des règles finiront par s’écraser, prévoit-il. Ce sera d’autres logiques qui vont gérer.»
Au premier chef, la logique comptable.
Dans son rapport de surveillance des communications publié en octobre, le CRTC estimait que 58% des 18-34 ans étaient abonnés à Netflix en 2014, soit le double de l’année précédente. Chez les francophones, le nombre avait triplé pour atteindre 24%.
De son côté, la firme eMarketer estime que Netflix compte plus de quatre millions d’abonnés au Canada.

Il y a un certain acharnement à s’en prendre à Netflix lorsqu’il est question du paiement des taxes à la consommation. Plusieurs autres entreprises étrangères ne chargent pas les taxes non plus. Je ne paie pas de taxes quand je commande des films sur l’Apple TV ou le Nvidia Shield TV. Je n’en paie pas non plus sur les jeux de la PS4. Plusieurs commerçants en ligne font transiter leur produits par l’Alberta où il n’y a pas de taxes à la consommation. Peut-être faudrait-il convenir que les entreprises qui n’ont pas de place d’affaire au Canada soient exemptées de payer les taxes canadiennes. C’est injuste pour les entreprises locales, mais je pense qu’elles ont aussi un avantage concurrentiel, car elles offrent des produits locaux que les multinationales comme Netflix n’offrent pas.
Je n’aime pas l’attitude des gens comme Louis Dussault qui jouent à la victime en criant au grand méchant loup. Qu’il se relève les manches et qu’il travaille avec les autres distributeurs et les institutions publiques comme la SODEC pour trouver des solutions originales pour notre marché.