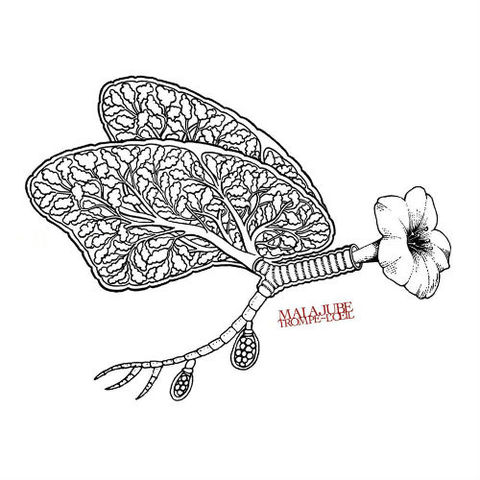
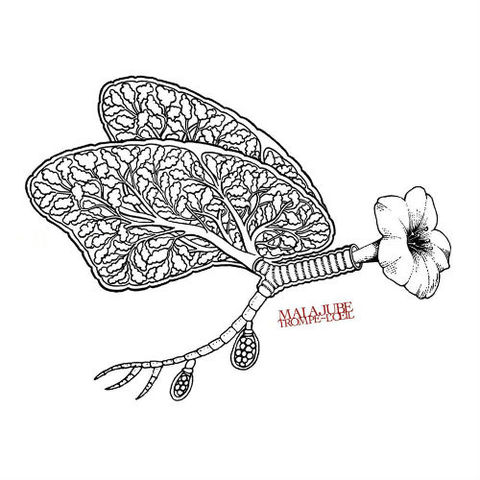
Il y a 10 ans : Malajube – Trompe-l’œil
Publiée sur une base régulière, cette chronique vise à souligner l’anniversaire d’un album marquant de la scène locale.
Récompensé à l’ADISQ, nommé au Polaris et encensé à l’international par plusieurs médias d’envergure, dont Spin, Pitchfork et New York Times, Trompe-l’œil demeure un point d’ancrage important de l’histoire musicale québécoise. Retour sur les étapes de création de cet album culte et analyse de son impact, en compagnie de Francis et Julien Mineau.
Paru le 7 février 2006 sous Dare To Care Records, Trompe-l’œil a eu l’effet d’une bombe.
Déjà connu des mélomanes québécois, en raison de son premier album Le compte complet, qui avait connu un certain succès sur les radios alternatives à sa sortie en 2004, Malajube est rapidement devenu, avec ce deuxième album, une icône de ce qu’on appelait communément la «scène émergente montréalaise».
«Y’avait de la pression à cette époque-là», admet Julien Mineau. «Ça reste une pression de gars de 23 ans, mais quand même.»

Enregistré au courant de l’année 2005, en partie dans un Breakglass Studio aussi neuf que peu chauffé, ce deuxième album du groupe sorelois avait été écrit et composé plusieurs mois avant. «On roulait les chansons depuis au moins six mois en show. Elles étaient déjà pas mal connues du public», se souvient l’auteur-compositeur-interprète. «Restait juste à les améliorer.»
«Y’a rien qui pressait vraiment, on avait du temps», se rappelle le batteur Francis Mineau. «On avait une structure de base pour les chansons, mais l’idée de la réalisation était pas encore arrêtée. On savait pas vraiment où on s’en allait avec tout ça… On finissait une maquette de toune, on ajoutait de quoi, ça déboulait. C’tait pas mal un gros «free for all».»
De ce tourbillon créatif et ce brassage d’idées est finalement né Trompe-l’œil, un album plus étoffé et ambitieux que son prédécesseur, autant au niveau des compositions que des arrangements et de la réalisation. «C’est vraiment là qu’on a appris à enregistrer», indique le chanteur qui, à cette époque, était inspiré par The Unicorns et Broken Social Scene. «Ça sonne pas bien? Ajoute une track. Ça sonne pas encore bien? Ajoute une autre track!»
«C’était l’énergie de la jeunesse qui nous «drivait». Ça parait pis ça s’entend sur le disque, même 10 ans plus tard», ajoute le batteur.
Succès instantané
Combinant le son indie pop du moment à une énergie punk brute et juvénile, Trompe-l’œil a connu un succès instantané, notamment grâce aux critiques dithyrambiques qui accompagnaient sa sortie.
«C’est l’album qui a changé toutes nos vies», admet Julien Mineau. «On a tourné presque sans arrêt pendant deux ans. C’était fou.»
Soutenu par un bassin de fans imposant, Malajube a rapidement profité de cet engouement généralisé, en signant un contrat avec une compagnie allemande pour sa promotion et ses tournées européennes. Grâce à un album distribué aux États-Unis, dans quelques pays d’Europe et au Japon (!), le groupe a ensuite multiplié les mentions médiatiques (très) favorables au courant de l’année 2006.
En plus d’obtenir des bons mots de la part du New York Times et de Spin, Trompe-l’œil a obtenu une élogieuse critique de la part de Pitchfork, qui soulignait notamment son intensité et ses arrangements inventifs.
Sacré révélation de l’année au Gala de l’ADISQ 2006, Malajube est devenu le représentant francophone d’une scène indie montréalaise très forte qui, depuis quelques mois/années, étaient sur toutes les lèvres (notamment celles du New York Times), grâce aux succès de groupes comme Arcade Fire, The Dears et The Stills.
À ce moment, Malajube était l’un des seuls groupes francophones à réellement pouvoir susciter l’intérêt de part et d’autre à Montréal. «Il y avait plein de bands anglophones qui tripaient sur nous autres et qui nous prenaient en première partie», se remémore Julien Mineau, énumérant notamment The Unicorns et Arcade Fire. «Même qu’ils nous encourageaient à chanter en français.»
«Nos influences musicales n’étaient clairement pas québécoises, mais Julien a trouvé des solutions pour faire entrer le français là-dedans», renchérit Francis, en référence au mixage de la voix – souvent «perdue sous les décibels», comme le rapportait Olivier Robillard Laveaux dans son élogieuse critique.
«Sa force, c’était de mélanger les deux cultures. Je pense que c’est pour ça qu’on a eu du succès autant chez les anglos que les francos.»
L’importance et les limites du français
Évidemment, d’autres artistes avaient déjà pavé la voie à Malajube. Auparavant, des groupes phares de la scène punk rock alternative québécoise des années 1990, comme Grimskunk et Groovy Aardvark, avaient également obtenu un succès important chez les deux publics en chantant en français sur une musique historiquement anglophone.
C’est d’ailleurs un groupe issu de cette vague qui a motivé Malajube à aller de l’avant avec le français. «J’me souviens que les Vulgaires Machins ont été une grosse inspiration», admet le batteur. «Julien et moi, on s’était clairement dit que si eux autres le faisaient en français, on le pouvait, nous aussi.»
Et il va sans dire que Malajube a eu un effet similaire sur la scène locale.
À défaut d’avoir été copié à outrance par la horde de groupes indie rock québécois qui l’ont suivi, comme cela a été le cas pour Karkwa par exemple, le groupe a sans doute eu une influence sur le choix linguistique de certains d’entre eux. «C’est l’une de nos plus grandes réussites», indique Francis Mineau. «C’est pas nécessairement un choix qui va de soi dans un style musical comme le nôtre.»
En revanche, à l’international, la langue française a «autant aidé que nuit», selon ce que rapporte le batteur : «Y’a beaucoup de gens avec qui on travaillait aux États-Unis qui remettaient en cause notre choix. Pour eux, ça aurait été bien plus facile de nous booker si on faisait de la musique en anglais… En même temps, si on avait fait ça, ça aurait peut-être pas été aussi original. On serait peut-être plus passés dans le beurre.»

Sans nécessairement évoquer le français, Julien Mineau reste lui aussi sceptique ou, du moins, réaliste face au succès que le groupe a eu (ou aurait pu avoir) à l’international. «Oui, on tournait beaucoup, mais je sais pas si ça valait la peine d’en faire autant», admet-il. «À un moment donné, on est arrivés à un constat : on faisait faire de l’argent à une compagnie et nous, on brûlait tous nos profits à rouler. Y’avait à peu près un show sur cinq qui valait la peine. On nous faisait jouer un mardi dans un village allemand pour boucher un trou, par exemple.»
Chez nous, on doit toutefois reconnaître que Trompe-l’œil a eu un effet monstre et a, en quelque sorte, cristallisé l’esprit de la «scène émergente» de l’époque.
Après tout, c’est notamment grâce au succès de cet album (et à ses singles, qui ont mystérieusement réussi à se frayer un chemin dans les radios commerciales) que de petites compagnies de disques, comme Dare To Care et Bonsound, sont devenus, quelques années plus tard, des joueurs importants de l’industrie musicale québécoise.
«Ces nouveaux labels-là osaient prendre des risques», pense Francis Mineau. «Je crois que ça a forcé les compagnies plus traditionnelles à s’adapter et à ouvrir leurs horizons à des trucs un peu plus éclatés.»
